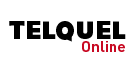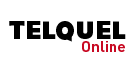Société :
Les orphelins de l’islam*
|
Les parents adoptifs ont un devoir
d’éducation
jusqu’à
la majorité de leur
enfant |
Ils sont près de 30.000 au Maroc. Enfants abandonnés
ou orphelins, ils sont des laissés pour compte. La société
condamne l’adoption quand la loi rejette la transmission de
filiation. Par Laetitia Grotti
Une
petite pièce au premier étage du centre Lalla Meryem pour les
enfants abandonnés, à Rabat. Des couples, dont les dossiers
suivent leur chemin dans les méandres administratifs, sont là
pour voir les enfants et être vus d’eux (ainsi que des
assistantes sociales). Une autre pièce aux murs blancs
mais |
|
avec cette fois le poster d’un
beau bébé joufflu, qui vante les mérites du lait artificiel
pour ces futures mères de cœur. Dans cette institution, le
dialogue s’installe entre couples, les interrogations se
partagent, les expériences s’échangent. Les regards des futurs
"adoptés" et de ceux qui en auront peut-être la garde, se
croisent, s’attardent. De l’autre côté, les travailleurs
sociaux observent les gestes, les attentions de ces
prétendants à la paternité et à la maternité.
Les enfants
qui sont ici le sont parce qu’ils ont été abandonnés ou parce
qu’ils sont orphelins. Les couples qui viennent dans les
centres comme celui de Lalla Meryem, y viennent pour combler
un vide affectif ou pour des raisons humanitaires. Mais
quelles ques soient les motivations qui lient ces destins, les
futurs adoptants savent qu’ils ne seront jamais considérés, au
regard de la loi et bien souvent de la société, comme de
"vrais" parents. Ils savent que leur enfant adoptif ne portera
jamais leur nom et ne sera jamais considéré par la loi comme
leur héritier. Pour la simple et bonne raison que l’adoption,
au sens d’une transmission de filiation, est interdite au
Maroc. L’article 83-3 du code de la famille stipule en effet
que "l’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne
aucun des effets de la filiation". Est en revanche autorisée,
la "kefala" ou sorte de tutelle légale sans que le lien de
sang ne soit rompu avec les parents ou la mère biologique,
s’ils sont connus. La kefala confère aux parents adoptifs un
devoir de protection, d’éducation et de soin jusqu’à la
majorité de leur enfant. Mais ce dernier ne pourra en aucune
façon prétendre aux mêmes droits que l’enfant légitime.
Pratiquement, il ne portera pas le nom de ses parents adoptifs
et ne figurera pas sur leur livret de famille. Une sorte de
marquage de la société. Encore s’est-il allégé depuis que la
loi de 2002 a supprimé l’infamant "de père inconnu" sur le
livret de famille pour le remplacer par un patronyme, mais
toujours différent de celui du père adoptif. Cet enfant n'aura
pas non plus de vocation successorale, c'est-à-dire qu'il
n'héritera pas de plein droit de ses parents adoptifs. Certes,
pour pallier cette injustice, la kefala permet d’instituer,
par testament, son enfant adoptif légataire et ce, jusqu’à
concurrence du tiers de ses biens. Mais au regard de la loi,
il demeure "l’autre", "l’étranger". L’adoption, dans son sens
étymologique, n’existe donc pas, en droit musulman, pour
lequel il s’agit plutôt "de prise en charge".
Pour Jamila
Bargach, professeur de sciences sociales à l’École nationale
d’architecture de Rabat et auteur d’un très fouillé Orphans of
islam (Les orphelins de l’islam, publié en 2001) "il est très
difficile, dans nos sociétés musulmanes, d’accepter
l’existence de ces enfants abandonnés. Ils remettent en cause
la structure sociale, le contrôle de la sexualité, les liens
sacrés du sang. Leur existence oblige à se poser des questions
douloureuses : qui abandonne et pourquoi ?". Dans la grande
majorité des cas, des mères célibataires appartenant aux
classes sociales les plus populaires. Souvent très jeunes,
arrivant de la campagne, elles se laissent séduire par des
promesses de mariage, rêvent à des lendemains meilleurs.
Ceux-là mêmes qui se transforment en cauchemar, une fois
enceintes et le promis envolé. Or, quelle possibilité offre la
société marocaine à la jeune mère célibataire ? Quel regard
porte-t-elle sur elle ? N’est-elle pas une "dépravée", celle
qui, comme le dénonce Aïcha Chenna de Solidarité féminine, "a
l’honneur de la famille entre ses cuisses et l’a souillé ?".
L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) le
relève comme une évidence, "l’abandon est une conséquence du
rejet et de la marginalisation de cette situation (mère
célibataire) par la société. Les mères qui abandonnent leur
enfant ne bénéficient d’aucun appui ou de reconnaissance de
leur situation de la part de leur famille, de leur employeur
et du père de l’enfant". Tout est dit. Alors, que faire ?
Laisser à d’autres - et pas toujours dans les conditions
fixées par la loi - le soin d’élever votre enfant, en espérant
qu’ils lui prodigueront ce qu’on ne peut leur donner. Aïcha
Chenna bondit : "Si la société était moins hypocrite, ces
femmes pourraient élever leurs enfants, mais il y a une telle
condamnation que bien souvent elles l’abandonnent à l’hôpital
quand ce n’est pas dans la rue". Comme Yasmina, à peine plus
de 20 ans. Violée par le fils de son employeur, elle se
retrouve à la porte, son bébé sous le bras : une petite Leïla.
Pas question pour elle de retourner dans sa famille.
Désespérée, elle se confie un jour à une femme et lui dit :
"Cette enfant va mourir". L’autre, simplement : "Donne la moi,
je l’élève". Le don fut fait. Dans ces cas là, on ne parle pas
de kefala mais d’adoption illégale, suivie généralement d’une
fausse déclaration d’accouchement que l’on présente ensuite à
l’état civil pour y faire inscrire le nouveau-né. Combien
d’autres femmes ont-elles déclaré avoir accouché chez elle et
présenté deux témoins, pour justifier de l’absence de
déclaration d’accouchement ? Combien, encore, jouent les
"mères porteuses" pour d’autres et accouchent sous le nom de
la mère adoptive ? Ni vu, ni connu. Dans ces cas précis de
fausses déclarations, où l’enfant apparaît sur l’état civil
des parents et porte donc leur nom, il est fréquent que
l’enfant soit informé de ses origines brutalement. "Si lui ne
les connaît pas, car c’est un tabou dans la famille, autour de
lui, tout le monde est au courant", explique Jamila Bargach.
Quand ce ne sont pas les 'ould haram' et autre 'ould haram men
f’aileck' crachés à l’école, inévitablement, il y a quelqu’un
qui un jour vend la mèche, volontairement ou pas". Le marquage
encore. À jamais indélébile. "Ils ont l’impression d’être
coupés de l’arbre, d’être sans aile", poursuit-elle avant de
conclure : "Comme si le jugement social en faisait
l’incarnation du Mal. De victimes, ils deviennent des
coupables en puissance".
*Titre de l’ouvrage de Jamila
Bargach, traduit de l’anglais "Orphans of
islam" |
 |
Témoignage : Dire
la vérité est une bonne chose
Mustapha et Sofia se souviendront
toute leur vie de ce jour de 2001, où ils se sont vus
confier la garde de Mehdi, par le centre Lalla Meryem.
Avant d’entrer dans cette "nouvelle aventure familiale",
ils durent affronter nombre d’interrogations, de
questions, de doutes, voire de peurs. Les réticences
d’usage de la famille, mise dans la confidence. D’autant
que, contrairement à la majorité de ceux qui se décident
pour une "kefala", parce qu’ils ne peuvent avoir
d’enfant, Mustapha et Sofia en avaient déjà deux,
biologiques. "Nous avons voulu les impliquer dès le
départ". L’aîné, alors âgé de 8 ans et le second, de 3
ans, accompagnent leurs parents à l’orphelinat pour
"choisir" leur futur "frère" ou "sœur de lait". "On peut
presque dire que ce sont eux qui l’ont choisi, se
souvient Mustapha. En fait, Mehdi est le premier que
nous avons vu. Nous nous étions présentés un jour où les
visites étaient théoriquement interdites, mais la sœur
nous a laissés entrer. En entrant dans la chambre, Mehdi
pleurait. Elle l’a alors pris dans ses bras et après
quelques minutes nous l’a passé. Comment expliquer ce
qui se passe ? C’est inexplicable, c’est comme un coup
de foudre". Le jeune couple a déposé son dossier en
janvier devant la commission administrative de la
wilaya. "Ils enquêtent sur votre environnement, vos
revenus, vos motivations. Nous avons également rencontré
des assistantes sociales". Du coup, le couple aura la
garde effective de Mehdi, 8 mois plus tard, en juillet.
Délai raisonnable, diront certains. "Long, trop long,
déplore Mustapha. Affectivement, c’est très dur. Car
nous avions choisi Mehdi bien avant d’en avoir la garde.
Nous venions le voir tous les jours, mais le soir il
fallait rentrer à la maison, sans lui". Enfin, le jour
tant attendu arrive. Cela fait aujourd’hui près de 3 ans
que Mustapha et Sofia vivent "une expérience familiale
extraordinaire. On dit toujours que ce sont ceux qui
"adoptent" qui donnent. Je peux vous dire que c’est loin
d’être une relation à sens unique. Vous recevez
énormément d’amour en retour. Même les enfants, c’est
super de voir comme ils sont ensemble. Ils s’entendent
très bien, se chamaillent comme tous les frères et
sœurs". Dans la famille aussi, Mehdi a conquis tout le
monde. Certes, au début de leur démarche, les réticences
s’étaient faites au grand jour : "Vous allez au devant
de problèmes, vous avez déjà des enfants, l’héritage…".
La bonne surprise sera au rendez-vous. "Quand les gens
sentent que vous êtes convaincus, que vous assumez,
alors ils sont conquis par la situation", témoigne
l'heureux papa. "Les enfants sont spontanés, naturels,
contrairement aux adultes qui sont plus crispés. Ils ont
tout de suite intégré Mehdi comme leur frère et pour
eux, il n’y a aucun doute. Alors forcément, ça vous
aide. C’est vrai que je redoute le moment où il ira à
l’école et où on l’appellera d’un autre nom que le
nôtre. Je crains aussi la période où il recherchera ses
parents biologiques. Il paraît que c’est quasiment
inévitable, surtout à l’adolescence. J’ai conservé les
pièces de l’enquête de police, au cas où il voudrait
savoir où, comment, dans quel état il a été confié à
l’orphelinat ? Dire la vérité est une bonne chose. Cela
évite de véritables drames, notamment quand "l’adopté"
ne sait pas qu’il l’a été, qu’il le découvre par hasard,
via une tierce personne, où à l’occasion d’un héritage".
S’ils ont un conseil à donner à de futurs candidats ?
"Allez-y
!". | |
 |
Loi : La kefala
dans le texte
La kefala est un concept juridique reconnu au
niveau international. Ainsi, la Convention des Nations
unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant reconnaît dans son article 20, comme moyen de
protection aux côtés de l’adoption, "le placement dans
une famille, la kefala de droit islamique ou, en cas de
nécessité, le placement dans une institution". Au Maroc,
cette procédure est actuellement régie par la loi 15-1
relative à la prise en charge des enfants abandonnés,
promulguée par le dahir n°1-02-172 du 13 juin 2002. Elle
consiste en "l’engagement de prendre en charge la
protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant
abandonné au même titre que le ferait un père pour son
enfant. La kefala ne donne pas de droits à la filiation
ni à la succession". C’est le juge des tutelles du
tribunal de première instance qui rend une ordonnance
confiant la kefala de l’enfant abandonné au couple ou à
l’institution qui la demande. Parmi les avancées
notables de cette loi, la possibilité pour une femme
musulmane remplissant les mêmes conditions que celles
demandées aux couples, d’introduire une demande de
kefala. Pour être exigible, il faut être musulman, avoir
l’âge de la majorité légale et être moralement et
socialement apte à assurer la kefala et disposer des
moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins.
Ne pas être atteint de maladies contagieuses ou rendant
incapable d’assumer ses responsabilités, ne pas avoir
été condamné pour atteinte à la morale ou commise à
l’encontre des enfants, ne pas avoir de contentieux
juridique avec l’enfant dont est demandé la kefala ou
avec ses parents. Après 12 ans, la kefala d’un enfant
est subordonnée à son consentement personnel. De la même
façon, c’est le juge des tutelles qui octroie
l’autorisation, provisoire ou permanente, de sortie du
territoire national. Si la personne assurant la kefala
souhaite faire bénéficier l’enfant qu’elle a élevé d’un
don, d’un legs, de tanzil ou d’aumône, le juge des
tutelles du lieu de résidence de l’enfant veille à
l’élaboration d’un contrat en ce sens. Mais cela ne
pourra dépasser le tiers de
l’héritage. | | |